L'histoire de Mes Lunettes !
Il y a 16 ans, j'ai traduit du persan en français une nouvelle intitulée "Mes Lunettes". Je viens de la relire, et comme je la trouve marrante, je la mets ici pour que mes lecteurs, dont mon frère Fabrice, puissent en profiter. La voici avec sa petite introduction : Introduction : La nouvelle occupe une place particulière dans la culture iranienne. En outre, un certain nombre d'écrivains parmi lesquels figurent Sâdegh Hédâyate, Djalâl Al-é-Ahmad, et Mohammad-Ali Djamâlzâdeh dont les nouvelles ont été traduites en langues étrangères, sont connus au-delà des frontières de l'Iran. Le point commun entre ces auteurs c'est qu'ils essaient de présenter, à travers leurs nouvelles, la culture et la tradition iraniennes, dans toutes leurs particularités. Téhéran, février 1991 Mes Lunettes Cette aventure est tellement vivante qu'elle brille de son plus vif éclat dans les ténèbres de ma mémoire. Je l'ai encore toute fraîche à l'esprit, comme si elle avait eu lieu deux heures auparavant. Jusqu'à l'époque où j'étais en classe de 5e, je croyais que les lunettes, tout comme la canne et la cravate, étaient une mode européenne et que, seuls, les gens "civilisés" en avaient pour paraître plus beaux. Mon oncle, Mirza Gholâm-Rezâ, qui donnait beaucoup d'importance à sa tenue ( il portait des pantalons étroits et faisait venir ses cravates de Paris ), et qui était si extrême dans son modernisme qu'il avait été surnommé MONSIEUR[3] par les habitants de notre ville, avait été le premier homme que je connusse à porter des lunettes. Et le fait qu'il cirait ses chaussures avec amour, utilisait couteau et fourchette et avait d'autres habitudes venues de l'occident me fortifiait dans cette idée. En tout cas, je pensais que les lunettes n'étaient qu'une marque d'élégance et qu'on les portait pour être plus chic. Laissons là ce préambule et dépêchons-nous plutôt de parler de l'école où je faisais mes études. J'avais généralement été grand pour mon âge. Et ma mère - que Dieu la garde - rouspétait toujours lorsqu'elle nous achetait des habits, à mon frère et moi. Elle se moquait tout le temps de nous en disant que nous étions tous les deux de grands échalas et elle nous demandait si nous voulions aller manger notre soupe chez le Bon Dieu. Comparée à ma grande taille, ma vue, par contre, était très basse : je ne voyais pas très bien. Sans même savoir que j'avais une mauvaise vue, je m'installais machinalement, dans tous les cours, à un pupitre de la première rangée pour mieux voir le tableau noir. Vous êtes tous allés à l'école, et vous savez que les pupitres du premier rang sont réservés aux élèves de petite taille. Et ceci était toujours la cause d'une querelle. J'en venais toujours aux mains avec les nabots de la classe. De plus, comme j'étais sale bête sur les bords, mes pauvres camarades de petite taille qui suivaient les mêmes cours que moi, ayant peur d'une bonne raclée après la classe, se laissaient faire. Et c'est seulement le commencement de mon histoire. Un jour, devant l'école, un professeur arrogant et présomptueux m'a donné une grande gifle dont le bruit a retenti jusqu'au milieu de la cour et aux oreilles des élèves. Juste comme je me tenais l'oreille, tout en voyant trente-six chandelles, le professeur, après m'avoir adressé quelques jurons dignes d'un charretier, m'a lancé à la figure : J'avais aussi fort à faire à la maison. La plupart du temps, quand je me levais après avoir fini de manger, et comme je ne voyais pas bien, mon pied heurtait soit un verre d'eau, soit une assiette, soit la cruche d'eau. Et alors, ou bien je renversais l'eau ou bien je cassais l'assiette. Et comme mes parents ne savaient pas que j'étais à moitié aveugle et que je voyais à peine, ils se mettaient en colère. Mon père me lançait des gros mots. Ma mère, elle, me faisait des reproches : Espèce de chameau débridé! disait-elle, souillon, va ! Tu bousilles tout ... Et ça t'est égal ... Tu ne regardes même pas devant toi ; et s'il y avait un puits, tu tomberais dedans ! Malheureusement, je ne savais pas moi-même que ma vue était si basse. Je croyais que tout le monde voyait comme moi, pas plus. J'acceptais donc ces insultes ; dans mon for intérieur, je me faisais des reproches et je me disais : Fais gaffe quand tu marches ! Dans quel pétrin tu te mets toujours ! Tu t'empêtres tout le temps les pieds dans quelque chose et ça fait un scandale ! J'avais encore beaucoup d'autres problèmes. Je ne faisais aucun progrès en football ; je levais le pied tout comme les autres joueurs, je le pointais vers le ballon pour shooter, mais je le ratais toujours. Alors je rougissais, mes camarades riaient, et moi, j'étais vexé. L'événement le plus pénible a eu lieu un soir où l'on donnait une représentation de prestidigitation. Quelqu'un, ressemblant à Gholâm-Hossein le jongleur, était venu à Chirâz. Des hommes, des femmes et des enfants s'étaient déplacés en grand nombre pour voir ses tours de passe-passe. Cette représentation allait avoir lieu dans la salle de spectacle du lycée Châpour. Comme les deux meilleurs de chaque classe avaient droit à un billet gratuit, le censeur du lycée m'en avait donné un et je n'en étais pas peu fier. Ce soir-là, je suis donc allé à la représentation. Ma place se trouvait au dernier rang de la salle. J'ai fixé la scène d'un regard perçant ; le type est arrivé sur le plateau, il a sorti son matériel de prestidigitation et il s'est mis au travail. Tout le monde, autour de moi, était fasciné par ses jeux. Tantôt on s'étonnait, tantôt on avait peur et tantôt on riait et applaudissait. Mais moi, plus je clignais des yeux et plus je faisais d'efforts, moins je voyais. J'apercevais bien des silhouettes, mais j'aurais été incapable de dire qui faisait quoi ni où. A bout de nerfs, j'ai regardé mes voisins et j'ai demandé à celui qui était à côté de moi ce que le jongleur faisait. D'abord, il ne m'a pas répondu et puis il m'a dit : Ben, t'es aveugle? Tu ne vois pas ce qui se passe?! Ce soir-là, j'ai senti que je n'étais pas comme mes camarades, mais j'ignorais toujours le défaut que j'avais. Je sentais seulement qu'il me manquait quelque chose, et ce sentiment me plongeait dans une profonde tristesse, un chagrin indescriptible. Malheureusement personne ne comprenait mon problème. Et tout le monde me considérait, à cause de ces maladresses - qui étaient tout bonnement dues à ma mauvaise vue - comme un idiot, comme un crétin. Et moi, j'en étais venu à partager leur point de vue. * * * * * * * Cela faisait déjà quelques années que nous étions venus habiter en ville mais notre maison avait conservé une allure rustique. Avant, quand nous habitions au bord de la mer, il y avait toujours une dizaine ou une douzaine de personnes qui débarquaient de leur campagne avec cheval, âne ou mulet, qui s'invitaient tout d'un coup chez nous et qui s'installaient pour plusieurs jours. Ils faisaient donc la même chose à Chirâz. Mon père avait fait une chute du toit, mais il ne s'en préoccupait guère. Il avait mis en gage, chez un brocanteur, la maison et tout ou partie des meubles. En tout cas on n'arrêtait pas de servir et de loger des gens de passage. Quiconque était sans travail et sans domicile se mettait en route vers le sud et s'amenait chez nous à l'improviste. Mon père - que Dieu ait son âme - avait le coeur sur la main. Et grâce à ce coeur d'or, il aimait jouer au grand seigneur : il vendait sa montre pour mettre les petits plats dans les grands. L'une des personnes qu'on recevait souvent c'était une vieille femme qui venait de Kazéroune. Le jour de l'anniversaire de la mort d'Omar[4], elle chantait des chansons ridicules. Elle avait la langue bien pendue et elle mettait son nez partout. En fait, elle parlait drôlement bien et elle savait drôlement bien raconter les histoires. Nous, les enfants, on l'adorait, et quand elle venait chez nous, on se délectait de ses paroles. Tous les soirs elle nous racontait des histoires. Parfois, elle chantait aussi des chansons, et toute la maisonnée l'accompagnait en frappant dans les mains. Elle ne se gênait avec personne ; elle était la franchise même et ne critiquait les gens qu'en leur présence. Ma mère l'aimait beaucoup. D'abord, parce que toutes les deux étaient de Kazéroune et que les gens de cette ville savent vraiment bien s'entraider. Mais aussi parce qu'elle prenait toujours le parti de ma mère ; pour la défendre, elle reprochait toujours durement à mon père d'avoir deux femmes. Celui-ci en effet, après s'être marié avec ma mère, avait pris une deuxième femme. Bref, on aimait bien quand elle venait chez nous. Il ne faut pas que j'oublie de vous dire non plus qu'elle avait toujours avec elle le Zâd-ol-maâd[5], son livre de prière, le livre de Djoudi[6], et plein de livres de Ta'zieh[7]. Elle emballait tout ça dans un morceau de tissu. Elle avait aussi des lunettes ; des lunettes de l'ancien temps avec des verres ovales. Et puis, ces lunettes étaient tellement vieilles que la monture en était toute cassée. Et la vieille femme avait remplacé la branche gauche par un fil de coton qu'elle enroulait plusieurs fois autour de son oreille. Comme j'étais malicieux, un jour que la vieille femme n'était pas chez nous, je suis allé chercher son ballot. Tout d'abord, j'ai mis la pagaille dans ses livres. Puis pour m'amuser, et poussé par la malice et la méchanceté, j'ai sorti les lunettes, dont je viens de parler, de leur étui. Je me les suis mises sur le nez dans l'intention d'aller, accoutré ainsi, taquiner ma soeur et lui faire des grimaces. Ah ! Je m'en souviendrai toujours ! Cela a été pour moi un moment extraordinaire, sublime même! Dès que j'ai eu les lunettes sur le nez, le monde a complètement changé. Tout s'est transformé. Je me rappelle que c'était un après-midi d'automne. Le soleil était d'un jaune brillant. Les feuilles des arbres tombaient les unes après les autres, comme des soldats blessés. Moi qui, jusque là, n'avais vu, des arbres, qu'un fatras de feuilles pêle-mêle, je les ai vues soudain bien détachées les unes des autres. Moi qui avais toujours vu le mur en face de chez nous tout uni et tout lisse - les briques se fondant l'une dans l'autre sous la lumière rouge du soleil - je les ai vues distinctement et j'ai même pu discerner l'espace qui les séparait. Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir j'éprouvais ! C'était comme si on m'avait donné tout l'univers. Je n'ai jamais, depuis, ressenti la même chose. Ce moment n'a jamais eu d'équivalent par la suite. J'étais tellement heureux que sans raison, je me recroquevillais sur moi-même. Je faisais claquer mes doigts, puis je sautais de joie. J'avais l'impression que je venais tout juste de naître et le monde avait, pour moi, une nouvelle signification. J'étais tellement heureux que j'en avais perdu la parole. J'ai enlevé mes lunettes : j'avais de nouveau un monde flou devant les yeux. Mais, cette fois-ci, j'étais heureux et sûr de moi. J'ai replié les lunettes, et je les ai remises dans leur étui. Je n'ai rien dit à ma mère. Car j’ai pensé que si je lui en avais parlé, elle m'aurait repris les lunettes et m'aurait donné une volée avec le tube du narguilé. Je savais que la vieille femme ne reviendrait pas chez nous avant quelques jours. J'ai donc mis, dans ma poche, la boîte de fer blanc dans laquelle se trouvaient les lunettes, et je me suis rendu à l'école, ivre de joie et tout ragaillardi à l'idée de voir un monde nouveau. * * * * * * * C'était l'après-midi. Notre classe avait lieu dans un beau salon, le bâtiment de l'école étant une de ces anciennes résidences aristocratiques. En fait, il était situé dans une orangeraie. La plupart des murs et plafonds des salles étaient décorés de petits miroirs taillés. Et notre classe se trouvait dans l'une des plus belles salles. Elle n'avait pas de fenêtres. Comme dans les anciens salons, il n'y avait que des fenêtres avec des carreaux de verre coloré. Et quand le soleil de l'après-midi s'attardait dans cette classe, les visages innocents de mes camarades devenaient, à tour de rôle, comme les pierres précieuses transparentes d'une jolie bague. Ce jour-là, on avait, en début de matinée, un cours d'analyse grammaticale et d'analyse logique en arabe. Le prof d'arabe était un petit rigolo qui avait au moins 150 ans ! Tous ceux qui ont le même âge que moi et qui ont étudié à Chirâz le connaissent. Bon alors... comme maintenant j'étais sûr de bien voir, je ne me suis pas précipité pour m'asseoir au premier pupitre. Au contraire, je suis allé m'installer à la dernière rangée. Je voulais tester jusqu'où je pouvais voir avec des lunettes. Comme notre école était une école de petits aristocrates mais qu'elle se trouvait dans un quartier populeux, il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans les classes du premier cycle. Tel un champ de pommes de terre décimé par les doryphores, l'effectif de la classe diminuait chaque année un peu plus, car les élèves avaient tendance à abandonner histoire et littérature pour aller gagner leur vie à la sueur de leur front. Pour être franc, c'est par nécessité qu'ils étaient obligés de quitter l'école. On n'était pas nombreux dans notre classe; même quand il n'y avait pas d'absents les bancs n'étaient remplis que jusqu'à la sixième rangée. Mais comme il y avait, au total, dix rangées de pupitres, et que je voulais essayer mes lunettes, je me suis installé tout au fond de la classe. Et, puisque j'étais loin d'être un élève exemplaire, rien que le fait de m'asseoir à la dernière rangée m'a rendu suspect au vieux prof. J'ai bien vu qu'il me regardait de travers. Il se demandait sûrement comment ça se faisait que cette petite peste, contrairement à son habitude, s'était installée au fond de la classe. Il devait se dire qu'il y avait anguille sous roche. Les élèves aussi, étaient plus ou moins surpris ; surtout qu'ils me connaissaient bien ! Ils savaient que, pendant des années, je m'étais battu pour être au premier rang. Bon, le prof a quand même commencé son cours. Sur le tableau, il a écrit une phrase en arabe, et il a préparé des cases. Puis, il a écrit un mot en arabe dans la première case et, en face, il en a fait l'analyse. J'ai profité de ce moment pour plonger la main dans mon pupitre et m'emparer de la boîte à lunettes. Avec mille précautions, je les ai sorties de leur boîte et je me les suis posées sur le nez. J'ai mis la branche en fil de fer sur mon oreille droite et j'ai entortillé le fil de coton autour de mon oreille gauche. Ainsi affublé, je devais avoir une drôle de bobine ! Les petits verres en amande des lunettes n'allaient pas du tout avec mon visage rude, mes traits épais, mon nez long, busqué et rebelle ! Et même sans parler de mon physique, je devais être irrésistible avec les branches des lunettes, l'une en fil de fer, l'autre en fil de coton. Quiconque, même ayant récemment perdu père et mère, se serait tordu de rire en me voyant. Alors, vous parlez de l'effet que je pouvais faire sur les élèves de cette école qui se gondolaient pour un oui ou pour un non, par exemple s'ils voyaient une toute petite fissure sur le mur de la classe. Mais le ciel ne protège pas toujours les innocents. Une fois que le prof - ô combien magnanime - a eu écrit la première ligne, il s'est retourné pour jeter un coup d'oeil sur les élèves et voir, d'après leur visage, s'ils avaient compris. Soudain, il m'a aperçu. Ébahi, il a lâché sa craie et il a mis au moins une minute à scruter du regard mes yeux, mes lunettes et l'allure que j'avais. Moi, je ne me rendais compte de rien. J'étais fou de joie ; je nageais dans le bonheur : je pouvais maintenant, du fond de la classe, lire à toute vitesse sur le tableau ce que, quand j'étais au premier rang, j'avais un mal de chien à déchiffrer. Je me fascinais. Moi, je ne donnais aucune importance à ce qui venait de se passer. Le fait que je restais indifférent, que mon regard ne trahissait aucune angoisse a convaincu le prof de ses soupçons. Il était convaincu que je lui jouais encore un tour pour l'embêter, pour me moquer de lui. Tout à coup, comme un tigre en furie, il s'est précipité sur moi. J'ai oublié de vous dire que ce prof avait un fort accent de Chirâz et qu'il avait tendance à employer une langue très populaire. Alors, tout en avançant, il m'a dit avec son accent typique : Ah ! Ah ! Sale poison ! Tu t'es mis ton masque de comédien sur la figure, hein?! Tu crois qu'on est au théâtre ici? Avant que le prof ne se mette à parler, tous les élèves étaient restés silencieux, regardant fixement le tableau noir, mais dès qu'il a commencé à m'insulter ils se sont tous retournés pour comprendre de quoi il s'agissait. Et aussitôt qu'ils se sont retournés, aussitôt qu'ils m'ont vu portant les lunettes - que j'ai décrites précédemment - il y a eu comme un tremblement de terre, comme si une montagne s'écroulait. C'étaient les rires à tout casser de mes camarades qui secouaient la salle de classe et toute l'école. Ils se tordaient comme des baleines, ils se tenaient les côtes de rire. Cela a encore augmenté la fureur du prof. Il s'imaginait que j'avais fait tout ça pour me moquer de lui. J’ai repris conscience en entendant rire mes camarades et le professeur m'insulter. J'ai senti venir un danger. J'ai voulu précipitamment enlever mes lunettes, mais j'avais eu à peine le temps de les toucher que le prof a hurlé : N'enlève pas ces lunettes ! Viens d'abord te montrer à Monsieur le Proviseur dans cet accoutrement. Tu ferais mieux d'être balayeur ! A quoi ça te sert de venir à l'école ? Tu n'as qu'à t'en aller ! Va donc t'amuser aux osselets sur le toit de l'établissement de bains. Toute la classe continuait à être secouée d'un rire énorme. Quant à moi, pauvre malheureux, j'avais perdu tous mes moyens. J'étais frappé du mutisme le plus complet. Bouche bée et les lunettes toujours sur le nez, je continuais à regarder le prof. Juste à ce moment-là, il a bondi vers moi et s'est placé tout à côté de mon pupitre, une main derrière le dos, l'autre prête à me gifler. Ainsi posté, il m’a fait : Allez, va-t-en ! Va-t-en que je te dise... Moi, malheureux comme les pierres, je me suis levé, les lunettes toujours sur le nez. Et toute la classe qui se marrait ! Je me suis fait tout petit pour qu'au cas où il aurait voulu me donner une gifle je puisse l'éviter ou tout au moins ne pas la recevoir dans la figure. Je rampais donc devant le professeur quand, tout à coup, il m'a giflé en pleine figure ; la branche de lunettes en fil de fer s'est cassée et les lunettes sont restées suspendues en l'air ! Le tableau était d'un ridicule fini ! Et comme j'essayais de remettre mes lunettes en place, j'ai reçu deux violents coups de pied dans les fesses. Je n'ai même pas trouvé le temps de dire "Aïe" ! Je suis sorti de la classe à toute vitesse. * * * * * * Le proviseur, le censeur et le prof d'arabe ont eu une réunion. Après avoir longuement discuté de ce qu'ils devaient faire ils ont décidé de me mettre à la porte, et lorsqu'ils ont voulu me faire part de leur décision, je leur ai raconté le problème que j'avais avec mes yeux. D'abord ils ne m'ont pas cru, mais mes explications étaient si sincères que j'aurais attendri un rocher ! Quand ils ont été convaincus que ma vue était si faible, ils m'ont pardonné. Et comme le prof d'arabe fourrait son nez partout et qu'il s'y connaissait en toute matière, il m'a dit avec son accent habituel : Ben ... t'aurais dû me le dire plus tôt ! Pourquoi est-ce que t'as pas osé me le dire ? Bon, demain, après l'école, je te retrouverai à Châh-Tchérâgh[8] chez l'opticien Mirzâ Soleymân. Ma vie de peines et de misères ainsi que le mépris de la veille s'évaporaient. Le lendemain, après l'école, je suis allé dans la cour de Châh-Tchérâgh chez l'opticien Mirzâ Soleymân. Le prof d'arabe est venu lui aussi. Il a regardé les lunettes de Mirzâ Soleymân, les unes après les autres, il me les a mises sur le nez, et puis il m'a dit : Regarde l'horloge de Châh-Tchérâgh. Tu vois la petite aiguille ? Non ? J'ai donc essayé des tas de lunettes. Enfin, j'en ai trouvé une paire qui m'allait : je pouvais voir la petite aiguille de l'horloge. J'ai payé quinze krans[9] à Mirzâ Soleymân qui m'a vendu les lunettes. Je me les suis mises sur le nez, et je les porte depuis ... [1]. En persan, Chalvârhâyé Vasslehdâr. [2]. En persan, Quessé-yé Einakam. [3] En français dans le texte. [4]. N. T. Les musulmans chi'ites considèrent Omar comme usurpateur. [5]. Ce livre, écrit en persan mais dont le titre est en arabe, comprend des poèmes religieux et des prières. [6]. Recueil de poèmes tragiques racontant le martyre de l'imam Hossein à Karbalâ. [7]. Pièce de théâtre racontant les événements de Karbalâ. [8]. Quartier du Mausolée dans lequel se trouve la tombe d'Ahmad-ibn-Moussa, frère de l'Imam Rezâ, 8ème Imam chi'ite et qui est au centre de Chirâz. [9]. Unité monétaire qui avait cours à cette époque. Il y a dix krans dans un toman.

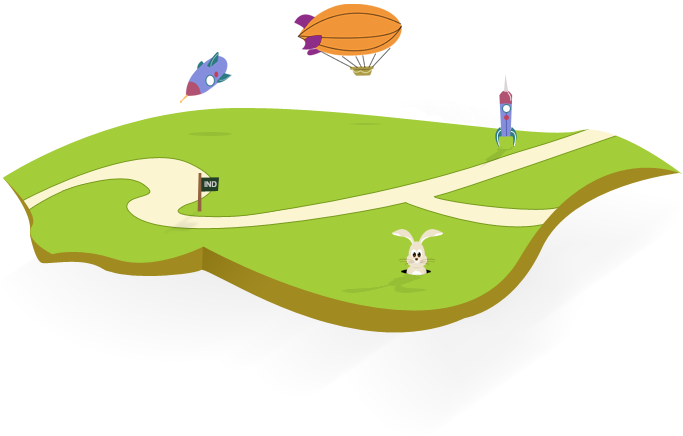

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/idata%2F0452788%2Fhamid_john-mer_int_rieure-hiroshima21102007.jpg)